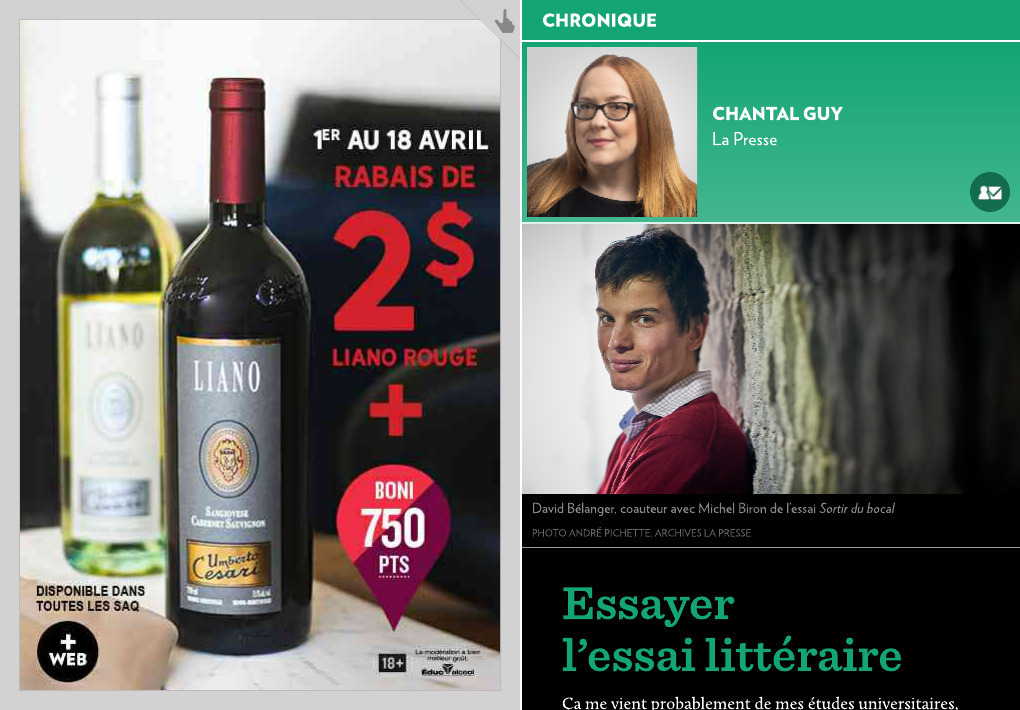Essayer l’essai littéraire
Ça me vient probablement de mes études universitaires, qui ont laissé une trace dans ma bibliothèque – j’ai conservé mes livres de Barthes, Kristeva, Todorov, etc. –, mais j’ai un gros penchant pour l’essai littéraire. Quand la fiction me sort par les oreilles, je me tourne vers ces écrivains qui écrivent sur les écrivains. Je n’en parle pas trop, car j’ai l’impression que c’est une lubie un peu pointue, comme celle des amateurs de timbres ou de mon chum qui collectionne les bandes sonores de films d’horreur des années 1980. Si je le laisse aller, il peut me vanter pendant des heures les mérites de Charles Bernstein ou Brad Fiedel.
Il est déjà difficile de nos jours de couvrir tout ce qui se publie comme romans, il reste peu de place pour parler de livres qui parlent de romans. D’ailleurs, à ce sujet, on a appris cette semaine que la maison d’édition Gallimard avait supplié les aspirants écrivains de ne plus lui envoyer de manuscrits pour une période indéterminée.
Le confinement en aurait inspiré plus d’un ; Gallimard recevait en moyenne 30 manuscrits par jour, la maison en reçoit maintenant 50, ce qui fait dire à certains que la France compte plus d’écrivains que de lecteurs.
Alors, bénis soient ceux qui lisent, ce sont eux qui tiennent en vie la littérature, encore plus lorsqu’ils agissent comme des passeurs. Prenez par exemple François Ricard, le plus grand lecteur de Kundera, qui vient de publier Le roman de la dévastation – Variations sur l’œuvre de Milan Kundera. Belle idée de réunir en un recueil les postfaces et critiques de Ricard pour chacun des livres de l’écrivain tchèque, qui l’a désigné comme son analyste attitré. C’est là que je me rends compte que j’ai plus lu Ricard sur Kundera que je n’ai lu Kundera lui-même !
Mais quand on est toqué de littérature, nul besoin d’avoir lu en profondeur toutes les œuvres dont il est question dans un essai littéraire, même si cela ajoute bien sûr au plaisir et à la compréhension.
En fait, les essais littéraires conduisent souvent à ouvrir des livres qu’on n’aurait pas ouverts sans eux. Je ne compte plus les écrivains vers lesquels l’écrivaine Chantal Thomas m’a pistée dans ses essais (le prince de Ligne, Fritz Zorn, Patti Smith, etc.). Parce qu’il n’y a pas mieux qu’un écrivain pour éclairer l’œuvre d’un autre écrivain, qu’il s’agisse d’Emmanuel Carrère à propos de Philip K. Dick, de Dominique Fortier sur Emily Dickinson ou de Michel Houellebecq pour Lovecraft.
Mais qu’est-ce qu’il y a de mieux qu’un écrivain qui écrit sur un autre écrivain ? DEUX écrivains qui discutent littérature. Et pour en faire un livre, la correspondance est la voie royale. Comme dans Sortir du bocal de David Bélanger et Michel Biron qui ont décidé de mettre à profit les heures creuses de la pandémie en s’écrivant. Le résultat est l’une des meilleures conversations que j’aie pu lire sur la littérature québécoise contemporaine, qu’on soit d’accord ou pas avec certaines de leurs conclusions.
D’abord, nous sommes en présence de deux vrais spécialistes, professeurs de littérature. Michel Biron est l’un des coauteurs de l’incontournable Histoire de la littérature québécoise, tandis que David Bélanger a publié notamment Il s’est écarté – Enquête sur la mort de François Paradis. Le grand thème de ce dialogue est l’ironie dans la littérature québécoise, et ce n’est pas sans ironie qu’ils se présentent eux-mêmes comme des produits de l’institution universitaire, en plus d’être hommes-blancs-hétéros. Citant l’exemple de La littérature et le reste, échange épistolaire entre les critiques Gilles Marcotte et André Brochu, Biron lance le jeu, souhaitant que la critique redevienne « une chose vivante plutôt que cette espèce d’épouvantable soliloque qu’elle est devenue dans nos innombrables évènements “savants” ». En gros, Biron et Bélanger sortent de leur bocal universitaire le temps d’une correspondance, loin du jargon de la thèse de doctorat dont le destin est souvent de passer « directement des presses universitaires au vide intersidéral », comme le souligne ironiquement Bélanger, et ça se lit comme un charme pour la simple raison qu’un dialogue respectueux, exigeant et amusant à la fois se développe entre deux professeurs de générations différentes.
Biron semble tenir plus à l’héritage et à la continuité que Bélanger, plutôt à l’aise avec l’éclatement actuel des lettres québécoises quand il lui confie : « je ne crois pas avoir déjà vécu dans un monde qui possédait cette forme d’unité aujourd’hui perdue. Je n’ai pas les moyens du regret ». J’ai d’ailleurs pu y apprendre qu’une suite de l’Histoire de la littérature québécoise est en chantier, mais que le projet se bute un peu à une époque de publication effrénée (le problème de Gallimard) qui résiste à l’esprit de synthèse qu’on juge arbitraire de nos jours.
L’ironie dont il est question, et je résume ici grossièrement, est cette mise à distance de la « grande culture » universelle dans les romans d’ici, où se prendre au sérieux ne fait pas sérieux, ce serait même une faute de goût, car comme l’a déjà écrit André Belleau, « chez nous, c’est la culture qui est obscène ».
Le clin d’œil ironique à la littérature avec un grand L, de Réjean Ducharme à François Blais, a la cote, en même temps qu’elle crée une espèce de communauté littéraire qui se méfie des institutions, méfiance que l’on retrouve dans les œuvres de Mathieu Arsenault et Anne Archet, souvent cités dans la correspondance. C’est un peu l’éternel drame de l’écrivain au Québec que cette impression d’écrire dans un entre-soi qui n’intéresse pas vraiment sa propre société, sans être capable de sortir de ce « bocal » dans lequel en plus le référent national est aujourd’hui « émoussé », selon Biron. L’hypothèse de Bélanger est que Ferron, Aquin, Ducharme, Bessette et Marie-Claire Blais n’ironisent pas sur le même signifiant que François Blais, Archet, Réhel, Arsenault et Gendreau, ni sur la même culture.
Mais l’ironie a ses limites à force d’en user, et les deux épistoliers se demandent même si elle n’a pas fait son temps. Dans ces temps tumultueux, un retour au tragique pourrait être possible, estime Bélanger, « et on pourrait alors se demander si l’ironie elle-même n’est pas en train de devenir obscène, comme signe d’un privilège, d’une oisiveté intellectuelle, d’une absence de souffrance à expurger ». Tout de même, il y voit aussi une manière de sincérité, même « minée », tandis que Biron y tient toujours, car pour lui, l’ironie est « un garde-fou, une façon de [s]e protéger contre les formes nouvelles de la mythification, contre l’excès de sérieux ».
Vraiment, Sortir du bocal est une lecture accessible qui suscite la réflexion, un livre écrit par des lecteurs de qualité passionnés, et, je le répète, qui se comprend sans qu’on ait besoin d’avoir tout lu des nombreux romans qui y sont convoqués pour les besoins de la discussion – même mon chum, qui ne lit pas beaucoup québécois, l’a dévoré. Au contraire, il donne envie d’aller tous les ouvrir pour vérifier par soi-même si Biron et Bélanger sont dans le champ, ce qui est à mon avis la plus grande qualité d’un essai littéraire.